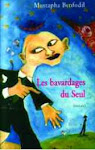Un haïku pour Chenôve
Vendredi 4 avril 2008. Troisième séance de l’atelier d’écriture « Médias Fictions ». Pour l’épisode d’aujourd’hui, j’ai suggéré à mes chers auteurs en verve de travailler à partir de l’exposition Ligne de Mire qu’abrite l’Espace Culturel jusqu’au 12 avril (vous devriez d’ailleurs vous hâter de la visiter pour ceux qui ne l’ont pas vue). Le fait est que le travail de Fred Gagné et Hervé Scavone n’a eu de cesse de m’interpeller tant par son originalité et sa force esthétique que par la multitude d’interprétations qu’il propose. Pour tout dire, c’est un matériau vraiment précieux pour quiconque s’ingéniant comme moi à explorer de nouvelles pistes d’écriture et de nouveaux « gisements » d’inspiration.
Je conviai ainsi les participants à prendre place à l’Espace culturel au lieu de la section jeunesse où nous avions pris coutume de nous retrouver. Je remarquai en cette troisième séance qu’il y avait une nouvelle tête en la personne de Anne-Lise, tandis que d’autres avaient disparu, les unes pour des empêchements personnels, les autres parce que pour elles, l’aventure s’arrêtait là. J’avais sciemment expliqué dès la première séance que l’atelier fonctionnait en modules indépendants les uns des autres et que l’on pouvait y faire un tour juste par curiosité sans que cela vous oblige à quoi que ce soit. Je me réjouis d’ailleurs qu’il y ait un nombre croissant de fidèles, déterminés à mener cette aventure expérimentale jusqu’au bout. Je salue leur assiduité.
Le principe pour cette séance était simple : il s’agissait de déambuler à travers les œuvres plastiques ainsi offertes et de s’abandonner à nos premières impressions et leur chaîne d’évocations. Le deuxième moment de cet atelier consistait à dresser chacun une liste de mots suscités sur le mode de l’écriture automatique. Les deux premières séances, nous avons travaillé à partir de fragments de journaux, des coupures de presse représentant des fragments de Réel que nous nous proposions de transformer en objets fictionnels, en récits colorés. Là, ce à quoi nous avions affaire, c’était plutôt des « fragments de Chenôve », un « concentré de Chenôve », ce qui nous offrait une matière idoine pour un reportage intimiste où il était question de traquer le réel non pas sur le terrain mais par le prisme de ce faisceau d’images à travers lequel la ville nous était restituée avec panache. On dit souvent que le reportage est le plus littéraire des genres journalistiques ; aussi me paraissait-il intéressant de s’y frotter, fût-ce d’une façon indirecte, détournée. Le but du jeu dans un premier temps était juste de recueillir un matériau brut par le moyen de l’observation. D’ailleurs, dans toutes les écoles de journalisme, on vous apprendra que l’observation représente 50% du reportage. Le deuxième moment de l’exercice consistait, comme avec les coupures de presse, à transcender ces « lambeaux de réel » et les recomposer sur fond d’une nouvelle trame faisant la part belle à la fiction, à la fantaisie, à l’imaginaire, et par-dessus tout, à la subjectivité et à la sensibilité personnelle, seuls gages d’une écriture véritablement nôtre. A un niveau, disons…« subliminal », le but ultime de l’exercice, dois-je le souligner, était de s’imprégner des ambiances de Chenôve et de faire le plein d’inspiration en prévision de l’écriture d’une nouvelle pour notre livre collectif dont j’avais parlé précédemment en introduisant cet atelier : « Le Roman de Charcot ».
*
A première vue, devant un tel florilège d’images, de signes, de tons et de couleurs, véritable forêt de signifiants, l’exercice pouvait confiner au blocage sémantique. Mais, comme je le disais, ma consigne était simple : promener nonchalamment son regard en s’attardant sur les petits détails sans en dédaigner aucun, fût-il anodin. Les participants se laissèrent ainsi entraîner par ce flot de stimuli, n’hésitant pas à baigner dans cet univers bigarré où l’humain et l’urbain s’entrelaçaient dans un mouvement syncrétique saisissant. Pour ceux qui n’ont pas connaissance du contenu de cette remarquable œuvre plastique, le peintre Fred Gagné et le photographe Hervé Scavone proposent de fixer sur leurs toiles différents visages de Chenôve, qu’il s’agisse de visages humains ou de séquences de la vie quotidienne : scènes de marché, des gens devisant allègrement dans leur jardin, d’autres qui jouent aux boules, des jeunes qui vaquent à leurs petits jeux badins, le tout travaillé avec des techniques mixtes mêlant coloris et photographie et emballé de rythme kaléidoscopique à vous donner le vertige. D’ailleurs, on peut voir défiler sur un écran des clichés de Scavone, et sur la scène sont étalés des photos imprimées, jetées en vrac autour d’un banc public. Les fresques de Fred viennent faire fondre tout cela dans une « pâte de vie colorée », habilement maillée à travers un chassé-croisé de constructions improbables.
Après une vingtaine de minutes, nous nous retrouvâmes à nouveau pour un petit brainstorming à partir de nos listes de mots respectives. L’objectif était de « mettre en commun » les impressions ainsi recueillies pour augmenter notre potentiel d’imagination collective. Marie-Luce nous honora à l’occasion d’un bouquet de mots surprenants comme « multitude et solitude », « empilement de souvenirs », « la vieillesse tranquille ». A ce stade de l’expérience, il ne restait plus qu’à passer à l’acte : écrire quelque chose à partir de cette archéologie du quotidien. Chacun s’installa dans un coin et lâcha bride à sa prose. Une farandole de textes s’ensuivit, et le résultat fut tout simplement étonnant. Anne Philippe ouvrit le bal avec un sublime haïku (genre littéraire japonais consistant à composer un petit poème en cinq pieds) avant que les autres, vainquant peu à peu leurs réticences, lui emboîtassent le pas jusqu’au tour de Patrice qui nous gratifia d’une démonstration magistrale d’analyse iconographique à partir d’une photo sibylline.
Au final, la moisson fut à la hauteur du challenge : prodigieuse. Je me ferai un plaisir de partager avec vous cette belle mosaïque de textes que je publierai dans ce même espace dans les tous prochains jours.
Bravo l’équipe ! Je suis très fier de vous.
Mustapha Benfodil