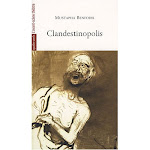LES NOUVELLES DE NADINE PICCOLO
S.A.J., Momo, Thérèsa et les autres
"C'était un jeudi, un frais matin d'avril. Une terrible implosion gronda dans le ciel et, en un battement de cil, Charcot s'évanouit dans un nuage de poussière sous le regard embué de S.A.J."
- Salut la compagnie !
S.A.J. lève à peine les yeux de son livre et salue Momo de la main.
Le calme matinal du café n'est troublé à cet instant que par le froid vif qui entre en même temps que le nouveau client.
Momo s’approche du bar, commande un café et patiente en regardant à la ronde.
-Salut Sadj ! Je peux ?
-Mouais…
Sans attendre de réponse plus claire, Momo tire la chaise bruyamment et s’installe. Le café déborde de la tasse, mouille le sucre mais il s’en moque.
En silence, il observe son ami de toujours. Toujours : quel drôle de mot ! Il y a bien un début, un commencement à tout. Leur amitié c’était comme le commencement du monde. Personne, même eux, ne savait vraiment comment ça avait commencé, où et quand ils s'étaient trouvés. Depuis longtemps, ils avaient plaisir à se rencontrer. Maintenant c'était au café du coin, sur un banc ou en flânant sur le mail, plus jeunes c'était dans les caves ou en bas des escaliers. Les années n'enlevaient rien à leur entente, bien au contraire, elles tissaient entre eux une toile solide.
S.A.J. s'arrête de lire. Son sourire est celui d’un enfant frêle, lui qui porte pourtant son mètre quatre vingt dix encore fièrement.
- ça va Momo ce matin ?
-Tu lis quoi ?
- Un truc…
- Ben j'vois bien !
- Je lis "Le roman de Charcot".
- C’est un nouveau, c'est un autre ? T’avais bien été le héros d’un bouquin qui s’appelait pareil ? Oui j'me souviens, c'est quand les intellos avaient écrit sur le « chtit » parce qu'on l'avait fait tomber, non :"imploser" qu'ils disaient.
S.A.J. sourit.
- Pas le héros, mais un des personnages, c’est vrai. Tu sais, le « chtit » comme tu l’appelles depuis toujours, toi, il est tombé mais avant, après, on avait tous envie et besoin d’en parler alors, peut-être bien que ceux qui ont écrit, ils ont parlé à notre place, pour nous, c’est bien finalement.
- Le "chtit" c'était parce qu'il était si grand, moi j'étais si petiot à l'époque que ce géant là, dès que je l'avais vu sortir de terre, j'avais eu besoin de lui faire la nique. C'était ma façon à moi de me grandir. Tu te souviens comme j'étais maigrichon et plus petit que tous les autres de la bande ?
- Oui mais tu t'es bien rattrapé plus tard, surtout pour ce qui est du poids !
- C'est malin…
- Je te taquine, tu le sais bien. Bon alors pour en revenir à ta question : oui c’est bien le même roman. Je l’ai trouvé dans le tiroir d’une commode quand ils ont sorti les "monstres" il y a quelques jours sur le trottoir. Je n'ai pas besoin d'un meuble de plus mais j’aime bien chercher, chiner, regarder les objets abandonnés, imaginer des histoires derrière tout ça, des morceaux de vie laissés sans qu’on y pense, voir les petites affaires de chacun.
- Trouver les billets ou les pièces aussi ?
- T’es bête, y en a qui passe avant de toute façon ! Pour moi, de l’avoir trouvé là, c’est un cadeau du ciel. Je l’ai chez moi, on me l'a offert quand il est sorti mais celui-là, c'est comme s'il n’avait pas voulu mourir et qu’il m’avait fait un signe désespéré avant d'être détruit bêtement par l'oubli.
- Toujours aussi romantique Sadj ? Tu m’en lis un bout ? Tu veux ?
De tout temps, Momo avait interpellé S.A.J. en l’affublant d’un petit « d » supplémentaire, un « Sadj » sonore. Il était resté longtemps évasif sur la raison de cette prononciation, même si S.A.J. l'avait questionné à maintes reprises.
- Ben, c’est que tu vois, s’enhardit-il un jour, S.A.J ça fait pas… enfin, avec un « d » c'est plus…
- ça fait plus arabe ?
Momo s'était tortillé sur le banc.
- Si c’est toi qui l’dit, moi ça me va ! avait-il finit par soupirer, comme tranquillisé d'avoir avoué une faute.
De la part de son ami, S.A.J. aurait tout pardonné, même les maladresses. Là était cachées leurs amitiés, leurs complicités et leurs heures passées à refaire le monde.
- Et toi Momo pendant qu’on en est aux confidences. Depuis toutes ces années, je n’ai jamais su ton prénom ou plutôt, tu en as dit tant et à tout le monde, qu’il est difficile de te croire.
- Je ne m’appelle pas Mohammed si tu veux savoir.
Ils avaient ri de bon cœur tous les deux.
- Je m’appelle Maurice, comme mon grand-père qu’est mort à la guerre. Ce qui est bien, c’est qu’avec mes cheveux noirs et un surnom comme çui-là, je peux plaire à tout le monde.
S.A.J avait été attendri par tant d’innocence.
Jamais Momo ne l’avait questionné, lui. Il avait toujours laissé son ami venir aux confidences, sans hâte, sans enquête. Sa famille, ses origines, le pays des anciens laissé au loin, même ses initiales curieusement, ne l’avaient pas rendu plus curieux qu’il ne faut. "Pas de barrières inutiles, pas besoin de savoir pour être pote !" C’était « les mots de Momo » comme il disait !
Les trois lettres, comme une trace, tel un tampon frappant à l’encre indélébile un carnet de naissance.
S pour Samir, l’ arabe, le compagnon de la veillée
A pour Avel, le juif, la fragilité des choses qui passent
J pour Jermen, le chrétien, issu du même sang
Les prénoms de pays qui se querellent, les prénoms qui se tournent le dos parfois mais ont croisé les femmes de la famille et ému les hommes pour qu’ils restent, un peu. Une identité entière dans cet acrostiche, palette de vie pour tisser des souvenirs quasi imaginaires. Son âme revue mais pas corrigée, ses ancêtres de tout horizon ajoutés et mélangés pour s’enrichir et se prévenir des affres des sectaires. S.A.J. aimait cet insigne, une fierté cachée dont il ne révélait rien, à personne. Un emblème pour gens de tout pays !
- Hé ! Tu rêves, tu me le lis Ton livre ou quoi ?
S.A.J. se remit à lire, à haute voix cette fois.
"C'était un jeudi, un frais matin d'avril. Une terrible implosion gronda dans le ciel et, en un battement de cil, Charcot s'évanouit dans un nuage de poussière sous le regard embué de S.A.J."
- T'étais pas tout seul à avoir la larme à l'œil. Tu te souviens comme elle pleurait ta Thérèsa quand il est tombé ?
- Si je me souviens, sûr que je me souviens même si ça remonte à loin maintenant. 2008, comme ça passe vite. Elle avait froid de partout. Elle se serrait contre moi, elle avait pris mon blouson mais rien n’y faisait, c’était de l’intérieur qu’elle était gelée. On aurait dit qu’on allait lui arracher le cœur. Si j’avais su ce jour-là que trois ans plus tard il s’arrêterait de battre son petit cœur, même pour moi.
Momo pose sa grosse main rugueuse sur le bras de S.A.J.
- Allez, allez, pense plus à tout ça. Elle se repose maintenant. Laisse là dormir.
S.A.J. reprend sa lecture, plus ému, plus grave. Sans pouvoir continuer, il lève la tête et regarde son ami.
- Ah ! Les premiers jours à Charcot ! Pour nous 68, ce n'était pas les manifestations, les grèves, c'était la salle de bains, les balcons qui donnent sur la ville, celle qui naissait sous nos pieds. On était des mômes alors on se faisait des courses dans les couloirs tout neufs, ça glissait bien à l'époque. Les rares familles qui étaient arrivées quelques semaines avant nous se sentaient déjà chez elles. Curieusement, elles voyaient d'un mauvais œil chaque nouvel arrivant. Je crois qu’elles auraient aimé rester toutes seules dans le bâtiment !
- Quel château ça aurait été ! Imagine si tu avais eu tout ça pour toi… qu’est-ce qu’on se serait marré ! Bon, on s'est déjà bien marré, c'est sûr ! "Un château majestueux, avec cèdre grand et fort devant l'entrée pour réchauffer madame les après-midi ou permettre à Monsieur de lire à l'ombre" Je rigole. Quand tu penses que des mômes avaient cet arbre pour eux tout seul, avant. Bon c'est sûr, il était moins costaud mais c'était une sacrée chance tout de même ! Paraît que les filles pendant la guerre, elles avaient enterré leurs poupées au pied de l'arbre pour pas que les soldats les trouvent. Elles y sont peut-être encore. Toute façon, vu l'Histoire qui se répète sans cesse, les politicards qui sont toujours à se chercher des noises, vaut mieux qu'elles restent cachées encore un peu, encore quelques siècles de patience, on ne sait jamais !
- Le soir, on répétait tous les mots entendus, enfin plutôt les injures qu’on avait apprises, dans les langues qu’on découvrait. Italien, portugais, arabe de toutes sortes qu'on n'arrivait pas toujours à différencier, même moi. Des mots français aussi car, à la maison, on le parlait mais à notre âge, on ne connaissait pas toutes les insultes.
- Quand j'y pense, on n'était pas en reste pour les chapelets de gros mots nous deux ! On avait même un cahier où le plus grand de la bande, Mustapha, le seul qui était dans la grande école et qui savait bien écrire, notait tout. Je ne sais pas ce qu’il est devenu ce calepin. Il était bleu avec écrit dessus : "NE PAS OUVRIR : DANGER !" en lettres rouges. Il écrivait les mots africains mais ils ressemblaient plus a des mots entendus dans les chansons anglaises de l'époque. On finissait par les savoir tous par cœur et tous les membres de la bande les prononçaient de la même manière, comme une langue en plus, une langue à nous, c'était poilant ! Des potes africains, au début, on n'en avait pas, on n'en connaissait pas d'ailleurs. C'est venu plus tard, quand les familles se sont installées plus nombreuses dans le quartier.
- Je m’en souviens du cahier. Mustapha le rangeait chaque soir dans un endroit différent pour que personne ne le trouve. J'avais peur qu'il lui arrive quelque chose dans la nuit et que le lendemain, on ne puisse pu retrouver notre trésor. Qui sait, on tombera peut-être un jour dessus, caché qu'il sera une dernière fois par Mustapha dans le tiroir d'une commode !
- Quand il a eu vingt ans et qu'il a commencé à sortir avec Amina, on les croisait parfois. On parlait de nos souvenirs d'enfance souvent avec eux et les copains qui restaient encore dans le quartier. Lui, il avait si peur qu'on en évoque certains devant elle, qu'il disait toujours : "J'suis désolé ! J’suis désolé !" avant même qu'on parle et nous on riait fort et on cherchait de plus belle si on en n'avait pas un pire en stock à raconter !
- On en a tant ! Tu te rappelles quand on avait enfermé le Manuel dans la cave ?
- Quelle rigolade, tu parles ! Il hurlait que le dieu des portugais allait nous faire frire.
- J’ai tellement ri, que j’ai pissé dans mon pantalon et que le soir, je me suis pris une fessée comme un gamin par ma mère !
- On a moins ri quand la mère de Manuel a croisé la tienne dans l’entrée de l’immeuble le lendemain et que le facteur a dû les séparer.
- Ah oui ! C’est vrai, je ne me souvenais plus de ça ! C’est drôle, tu étais si souvent avec moi, si souvent avec nous tous, j’ai toujours eu l’impression le soir, que tu allais dormir plus haut, dans la tour, et que tu ne retournais pas dans le village. Tu étais si différent des autres.
- Pour eux aussi j’étais différent. Moi, j’aurais aimé habiter partout. Voir du balcon les autres vivre, vivre avec eux, m'amuser jusqu'à point d'heure plutôt que de me sauver en vitesse parce que c'était l'heure de rentrer dans ma maison du bourg. Mais aussi, je voulais être quand même de Chenôve vieux, de mon village, là où ma grand-mère ses poules et là où j'aimais jouer au cow-boy en solitaire sur la colline. Les tognées que j'me suis prises en remontant le chemin. Les potes comprenaient pas que je puisse être copain avec les arabes qui disaient, même si d'arabe, à l'époque, y en avait pas beaucoup à part toi ! Et encore toi, t'es arabe et pas, hein ? Je me demande si c'est pas là que j'ai décidé de me faire appeler Momo, pour être un gars "des deux", des deux côtés, des deux mondes. Et quand je rentrais dans le "chtit" et que les copains disaient : "Tiens, voilà Momo !" Je crois que j'étais fier d'être de la grande famille de Charcot, fier d'être avec eux, avec toi. Comme les gars de Péguy, on avait même le chant de la barre… bon, je te le refais pas !
- Non, c'est bon… ! Epargne-moi !
- En fait, on est bien pareil tous les deux, même pour ça. Toi aussi, t'as été des deux mondes un jour.
S.A.J. penche la tête. Son trouble est perceptible. Ils ont en commun de se comprendre, de se deviner avec tact et de prendre le temps, encore et encore de redire les souvenirs, de rebâtir les moments et de les laisser remplacer le présent, pour un temps.
- Tu dis ça pour Thérèsa ? Toi t'étais l'ami, le frangin. Dans nos histoires de gosses, il n’y avait pas de place pour le racisme, la gêne ou la bêtise qu'amène tout ça. Parfois quand on s'empoignait pour jouer, ou qu'un de la bande était vexé ou en colère et qu'on se mettait la raclée, on se traitait de bougnoules, de crépus, de macaronis ou même de moules à gaufres. C'était jamais mauvais, pas entre nous, pas avec ceux de Charcot en tout cas. Mais elle… Elle c'était pour l'amour. Elle c'était l'autre monde, le pas à pas franchir qu'on a franchi quand même, malgré tout et tous.
Imagine !
Une fille aussi belle, si dansante quand elle marchait sur le mail, si joyeuse quand elle achetait son pain. Quand je la croisais, vrai, je baissais la tête.
- T'exagère pas un peu ?
- Je t'assure. Non, j'aurais rougi à la place alors, ça aurait été pire !
- ça c’est sûr, valait mieux que tu lui montres pas.
- Et un jour, comme dans les contes de fées, elle a glissé dans une flaque d'eau.
- Sauf que dans les contes, c'est toujours le soleil qu'amène la princesse !
Momo rit de sa bonne blague et commande deux verres de vin du pays.
- Tu me laisses dire quand je parle de Thérèsa. Ce n'est déjà pas facile pour moi alors, laisse-moi dire les mots comme je les sens. A moins qu'elle t'ennuie mon histoire d'amour ?
- Pas du tout, j'adore !
- Elle était là, sa robe jaune et blanche étalée autour d'elle comme une corolle, toute mouillée, fripée. Telle une altesse, elle restait assise sans faire mine de se lever. Quand elle a levé les yeux, j'étais là. Quelle veine, c'est moi qui étais là ! Je lui ai tendu la main et pour la première fois, la peau que je rêvais de toucher, je la touchais, les yeux que je rêvais de traverser, je les pénétrais, le sourire que j'espérais, elle me l'offrait. Elle retenait ma main contre elle mais ne bougeait plus. Moi, grand dadais devant l'éternel, je regardais par-dessus son épaule de peur que quelqu'un n'assiste à la scène, alors que mon cœur aurait donné cher pour que tout le monde me voie.
- C'est beau ! Et en plus, t'en rajoutes chaque fois un peu…
S.A.J. fronce les sourcils. Momo en profite pour trinquer.
- Quand on a commencé Thérèsa et moi à se chercher, se guetter, s'attendre en bas de la tour, c'est là que le bonheur a pointé son nez et… que les ennuis ont commencé. Ses frères étaient sans cesse en train de la pister. Il la suivait même au nouveau supermarché. Ma mère s'en mêlait. Elle prenait sa voix autoritaire et clamait devant tous au moment du repas, pour les prendre à témoin :"Paraît que tu fricotes avec la belle ritale du cinquième ? Tu peux pas te trouver une fille du pays ?" Je souriais plutôt que de m'énerver et je lui disais calmement :"M’mam, on est de combien de contrées dans notre famille, de quel pays faudrait que je te ramène une fiancée pour qu'elle soit à ton goût ?" Mon père mangeait sa soupe et souriait discrètement sans intervenir. Quand elle m'agaçait plus, quand ça tombait plus mal, je faisais le sourd, non : j'étais sourd. Les seuls mots que j'entendais étaient ceux de Thérèsa. Des mots doux, tendres et chauds et les tiens, quand tu me disais de les envoyer tous se faire foutre ceux qui se mettaient en travers de notre chemin.
- De quoi y se mêlaient d'abord ?
- De tout. Quand on vit tous ensemble comme à Charcot, on est si près des autres, tout est partagé sans le vouloir. Même si des gens se croisent pendant plus de dix ans sans se connaître, ils savent qu'il y a un nouveau-né dans la barre, que la voiture rouge est une nouvelle voiture dans le quartier, que la fille Truc ou Machin a marié un électricien et quel jour. TOUT je te dis. Les peines, les joies, tout se sait mais si mal. Les moments les plus intimes aussi sont vécus et partagés par d'autres sans qu'ils y soient invités.
Momo regarde S.A.J. et ils éclatent d'un rire sonore. La même image remonte le temps.
- Marcel, remets-nous un p'tit verre, les mots et les rires nous assèchent le gosier. Certains souvenirs un peu chauds, aussi !
- Qu'est-ce qu'on a pu rire ! C'était le jeudi, on n'avait pas classe et chaque fois que M. Piquouette (tu parles d'un nom !) passait la porte vers deux heures pour aller au jardin, sa bonne femme faisait grincer le lit peu de temps après. On n'a jamais su si c'était le même chaque fois qui venait la distraire, mais ils y allaient de bon cœur !
- Je crois que si on s'était fait prendre à les écouter, on aurait dégusté autant qu'eux !
- Vous avez l'air bien joyeux les "charcotis" ce matin ?
- Charcotis, charcotis : Ah Marcel ! Tu peux pas comprendre. T'es d'la campagne toi !
- T'es pas gonflé. Ça fait trente années que j'vous sers et j'suis pas d'ici ?
- Non, j'ai pas voulu te faire de la peine mais tu vois c'est pas pareil quand on regarde que quand on vit de l’intérieur et Charcot, c'est ça : y en a quand parlent, y en a même qui peignent des tableaux des années passées, des années perdues mais nous, on y était alors, on peut dire qu'on en a sur le cœur quand c'est le cas, et sur les lèvres quand on a envie de faire réapparaître ce bout de la vie ! Nous en veux pas si on est un peu chauvin, parfois.
- Bon, bon, peut-être bien que c'est ça la vie. Je vous laisse à votre matinée de vieux raconteurs d'histoires. Ils doivent quand même pas tous être aussi drôles vos souvenirs.
S.A.J. et Momo trinquent en se regardant. Nul besoin de mots pour savoir où va leur mémoire à cet instant. Le sourire disparaît doucement comme le soleil s'efface le soir derrière la butte.
C'est Momo qui enchaîne.
- Plus tard, le jour où t'es allé faire ta demande pour marier Thérèsa, j'aurais bien aimé qu'on puisse filmer : un vrai drame !
- Elle était fière, belle et fière. Elle avait tenu à s'endimancher même si c'était un jour de semaine. C'était des idées qu'elle avait ma tendre. Alors moi, j'avais dû faire comme elle. Je me sentais un peu idiot mais elle avait les mots pour que je sache que c'était bon et meilleur. Le reste, j'avais tôt fait de l'oublier quand elle roulait des yeux. Elle avait tout décidé : le jour, l'heure de la demande à ses parents. Notre rendez-vous se ferait au pied du cèdre avant de monter et pas ailleurs. Elle pensait qu'il serait notre premier témoin et que sans ça, on pouvait pas y croire vraiment à notre amour. Des "trucs de filles" mais moi, je sentais bien que ça avait aussi son importance. Le cèdre avait tout vu depuis tant de d'années, il avait supporté au moins deux guerres pour ce qu'on en savait ; qui aurait pu être plus sage que lui pour protéger nos âmes et nos sentiments, hein ? Elle voulait qu'on grave un cœur avec nos initiales dedans par contre ça, je n'ai pas voulu. J'avais peur qu'on le blesse et qu'il nous en veule. Elle avait sourit et avait ajouté que j'étais encore plus romantique qu'elle ! Je ne sais pas si c'était vraiment un compliment !
- Du bonheur pour après, du bon présage mais pas pour ce soir là… !
S.A.J. fixe un point clair sur la table en bois. La mémoire porte tout en elle. Le film est bien net, la bobine tourne.
- J'ai entendu les cris depuis le chemin. J'avais fait comme prévu. Je voulais pas tenir la chandelle alors on s'était mis d'accord pour se voir plus tard toi et moi, pour se raconter.
- Le père Francisi, il avait jamais dû crier autant, même après ses gars pourtant, c'était pas des anges. La mère de Thérèsa hurlait, elle aussi, qu'on lui volerait pas sa fille. On aurait dit les femmes du bled à elle toute seule quand elles pleuraient encore les morts. Je crois que je n'ai jamais su si c'est Thérèsa qui me l'a dit avec ses yeux ou moi qui lui ai tendu la main comme au premier jour, mais au même moment, on a dévalé les escaliers tous les deux. Fuir les cris, le bruit des adultes et leurs sales valeurs à la noix qui nous faisaient souffrir. RIEN, rien n'aurait pu nous retenir, nous arrêter. Tu vois Momo, si on savait des jours comme ceux-là, les jours qui font mal, comment ils se défont plus tard, on aurait sans doute moins peur de les vivre.
- Tout le monde vous cherchait. Moi je devais rentrer au village mais j'osais pas partir. J'avais confiance, j'étais sûr que vous vous feriez pas prendre mais j'avais peur aussi. Ils étaient tous devenus fous. On a bien cru à un moment que les Italiens allaient s'armer et s'en prendre à tous les Arabes du coin. "C'est la guerre" on entendait.
- Tu as raison, ça aurait pu très mal finir, la connerie humaine n'a pas de limite ! Ma mère et mon père nous cherchaient pour nous cacher. Mon petit frère et ma petite sœur, qui comprenaient un peu trop de choses pour leur âge, indiquaient dix fois des endroits différents où chercher, jurant qu'ils nous avaient vus ici ou là, même à ceux qui ne demandaient rien.
- Et soudain, y a le père de Manuel qu'a crié dans son mégaphone. J'ai su plus tard qu'il était à Paris en mai 68 et qu'il l'avait trouvé dans une rue pleine de barricades et gardé en souvenir. Je sais pas si pour faire la révolution il avait servi mais ce jour-là, oui ! Il a hurlé toute son histoire, on avait presque honte car TOUT, il a tout dit. La famille qui crache par terre, les amis qui s'éloignent, la grand-mère qu'à un arrêt du cœur pour la circonstance… Tout ça à cause de sa bretonne, sa mésalliance, celle qu'il aimait et qui lui a fait de si beaux gamins plus tard, qu'il disait. Nous les jeunes, on se marrait un peu. Il a continué en criant que quand on la regarde sa femme, quand on l'entend défendre ses fils, et nous tu parles si on était d'accord, elle était plus portugaise que ses propres cousines. Et il a fini par dire que si on était assez con pour pas avoir compris que Charcot c'était un pays à lui tout seul, une patrie toute entière, on serait malheureux partout ailleurs.
- Même cachés Thérèsa et moi, on a entendu le silence qui a suivi. Les murmures aussi. On tremblait mais on avait l'impression forte d'avoir assisté à un événement, un "tournant" dans l'histoire du quartier. A moins que ce soit aujourd'hui où ces souvenirs remontent, que j'ai ces pensées là. Les semaines, les mois ont passé. Nos vieux se sont calmés. On a pris un deux pièces à Renan et comme on ne voulait pas vivre dans le pêcher, on s'est marié dans l'année. Pas devant dieu, on ne savait pas lequel choisir et de prendre l'un ou l'autre, ça n'aurait pas été bon pour les familles.
- Tu dis que les esprits s'étaient calmés mais vu ce que vous avez reçu en cadeau le jour du mariage, tous n'étaient pas si contents de vous voir ensemble !
S.A.J. se penche en arrière sur sa chaise, ferme les yeux et repense à la scène.
L'enveloppe glissée sous la porte. La porte qui s'ouvre à la volée : personne !
Puis Thérèsa qui devine avant tout le monde que ce n'est pas du bon. Elle refuse qu'on ouvre la lettre. S.A.J. lui caresse la joue pour la rassurer, l'amadouer.
- J'ai jeté l'enveloppe par terre dès qu'elle a été ouverte, dit S.A.J. Une bien grosse qu'il y avait dedans et odorante avec ça !
- Oh ! Arrête ! Tu me dégoûtes.
- C'est quoi qui te dégoûte ? Le cadeau parfumé ou le salopard qui nous l'avait envoyé ? D'un bond ma Thérèsa s'est reprise et redressée et tel un soldat en partance pour la guerre elle a dit : "Autant que ça serve !" Elle a couru dans l'escalier avec sa robe blanche et est allée enterrer la lettre sous le cèdre. Elle parlait tout fort : "Tu as toujours eu faim d'histoires mon "gros pépère". Moi je ne veux plus entendre les mauvais qui tentent de nous gâcher notre amour. Prends cet engrais, prends tout son temps pour refaire le monde. Maintenant, tu as de quoi en imaginer un pire que les guerres et faire en sorte que ça finisse bien"
- Elle n'a pas retrouvé les poupées ce jour-là ? Si elles y étaient encore, elles ont pas dû aimer le nouvel arrivant.
- T'es bête ! Toujours le mot pour rire.
S.A.J. finit son verre ; ils sont bien là, à égrainer leur vie, leur Charcot à plein cœur.
- Elle en avait du caractère ta Thérèsa, du caractère et du cœur aussi. Le nombre de fois où elle m'a consolé, comme une mère, vraiment. Oh ! Pardon, j'voulais pas te blesser.
- Pourquoi me dis-tu ça ? Parce qu'on n'a jamais pu avoir d'enfant ? T'en fais pas, on a été si heureux nous deux que tous les jours de bonheur ont remplacé la tristesse, grandement. Le jour où le médecin nous a annoncé que Thérèsa ne serait jamais maman, j'ai pensé qu'elle ne s'en remettrait pas, qu'elle se laisserait aller et que la vie la mangerait toute crue. Mais elle est sortie du cabinet, elle a séché ses yeux en cachette pour faire la grande et elle m'a pris par le bras pour m'entraîner sur le mail. On a marché quelques minutes en silence. Quand elle a été prête, elle m'a bien fixé dans les yeux et en tremblant un peu elle a dit tout bas : "Si tu veux partir maintenant, tu peux. Je comprendrais. Je ne t'en voudrai pas. Mais si tu restes, ne m'en veux pas à ton tour. Si tu es prêt à vivre à mes côtés sans bout'd'choux qui courent dans la cuisine, sans les jouets de nos petiots qui traînent partout et bien je te le dis sans crainte : tu ne le regretteras pas. Je t'aimerai autant qu'une famille entière, celle qu'on aurait pu être car on le sera, je t'adorerai plus encore que si tes enfants avaient grandi à nos côtés. On se rattrapera de ce que la vie nous fait comme vacherie en s'aimant comme jamais personne ne s'est aimé avant nous. Et si t'es d'accord, des ragazis comme y en a plein dans l'immeuble, je leur servirai de Mama de temps en temps, pour dépanner.
- J'avais tenté de cacher mon émotion devant le docteur, j'avais réussi à planquer mes yeux rouges en baissant la tête quand elle parlait mais là, quand elle a déposé un baiser sur mes lèvres, j'ai éclaté en sanglots et je l'ai serrée contre moi fort, si fort. J'ai pris son visage entre mes mains et je me souviens parfaitement encore aujourd'hui ce que je lui ai répondu : "Donne-moi ton bras ma belle, on rentre à la maison. Avec tous les bons gâteaux que tu sais faire, elle n'est pas prête d'être vide !"
- Tu vas me fiche le bourdon. Je vais t'avouer quelque chose. Quand on l'a mise dans la terre, tout le monde était anéanti, le quartier était en état de choc. Le silence pesant avait même fini par effaroucher les pigeons pire que l'implosion. Moi, pour essayer de te consoler un peu, j'étais si maladroit, je disais des blagues débiles. Tout le monde croyait que j'avais bu un peu trop pour oublier. Personne évidemment ne riait. Mais aujourd'hui je peux bien te le dire, j'avais rien bu, rien de rien. J'ai couru après la cérémonie jusqu'à la maison, je me suis enfermé dans ma chambre et j'ai passé la nuit entière à la pleurer.
- ça m'étonne pas de toi. J'ai toujours gardé en moi un moment fort aussi. Lorsque je me suis penché pour embrasser ma Thérèsa une dernière fois, son père s'est approché de moi. Il a posé sa main sur mon épaule et il m'a dit tout bas :"Pardon, fils". On avait passé des moments autour d'une table, on avait fait des fêtes ensemble depuis tout ce temps qu'on était marié, mais c'est là, devant elle couchée et si pâle dans sa robe blanche, que j'ai su que je faisais vraiment partie de la famille.
- On va finir par ajouter des larmes au vin et c'est pas bon à boire. Bon, tu me le lis ce roman oui ou quoi ?
- Je n'ai pu trop le temps ce matin mais tiens, si tu veux, je te lis la dernière phrase et tu verras, ça finit bien !
S.A.J. ouvre le livre et lit les quelques lignes promises :
"Le cèdre qui veille sur Charcot et qui veille sur le Temps déploya ses branches comme une tulipe qui éclot, pour ouvrir ses larges bras verts au soleil. Et la lumière fut"
Nadine Piccolo
Mô Hâ Mëd
C’était un jeudi, y faisait froid, ça a fait du bruit !
Mô avait travaillé toute la semaine à la construction. Il avait choisi consciencieusement où bâtir sa maison et avec quels matériaux. Il savait faire du solide, du durable, de l'élégant aussi. Son choix était définitif : ce serait à Charcot et nulle part ailleurs ! Le vent de travers ne le délogerait pas, le soleil n'écraserait pas les lieux mais les réchaufferait. Un endroit fait pour lui et la famille qui suivrait.
Hâ souffrait d'une maladie incurable : le bonheur ! Ça ne paraît rien comme ça, ça semble même incroyable d'y penser comme à une tare mais à bien y regarder, c'était grave !
Il devinait le soleil à travers la brume, ça le rendait fou de joie. Il soupçonnait les nuages noirs d'être gorgés de pluie, il en était ému, au comble de l'émotion. On le poussait dans le bus ou chez le boulanger ? Il s'excusait et pensait tout bonnement qu'il était tant pour lui de poursuivre sa route ou de faire une pause un peu plus loin afin de ne pas déranger : un bon signe quoi !
Mëd avait une passion, un véritable hobby : le ménage !
Pas la vie à deux, si aléatoire et si fragile non, la chasse à la poussière. Dès qu'elle rentrait chez elle après le travail, elle se déshabillait entièrement, se lavait et enfilait un peignoir rose à fleurs. Ses cheveux enturbannés, bien serrés, elle chaussait ses patins à pompons violets et là, prête à se lancer dans une quête que Roland notre héros national ne dénigrerait pas, elle s'emparait de son plumeau et époussetait, furetait, traquait le moindre grain de poussière, la plus petite trace laissée dans la journée qui se trouvait à sa portée. La saleté virevoltait sous les effets de manches de la bonne ménagère et allait se déposer plus loin.
5 4 3 2 1 0
Mö appris ce jour-là que faire un nid au-dessus d'un immeuble de son choix n'est pas forcément une riche idée.
Hâ compris à cette minute que le bonheur est dans le pré.
Mëd sortit dans la rue avec son plumeau et devant toute cette poussière à récolter, elle pleura de joie.
Nadine 15 avril 2008
La mariée de pierre
Le voile blanc enrobe les formes de la mariée de pierre.
Elle sourit dans l’hiver cru. Parfois le vent s’encoquine de la belle et soulève sa traîne avec pudeur.
Se doute-t-elle de sa mort prochaine ? La laisse-t-on dans l’ignorance pour préserver sa virginité ou a-t-on peur, seulement, de la perdre trop vite alors, on se tait ?
Je regarde les draps tendus sur les murs comme ils le seraient sur les meubles bien cirés dans la maison familiale, à l’heure de tirer la porte pour une dernière fois.
J’ai froid quand le souffle se fait entendre. J’ai mal lorsque mes yeux se posent sur la toile blanche. Le linceul a remplacé l’hymen.
La mariée est couchée. Elle ne pleure pas, surprise qu’elle est de se retrouver là.
Elle ferme les yeux.
Pense à Rimbaud
Pense au soldat.
Elle a deux trous rouges au côté droit.
Nadine (atelier du 8/04)